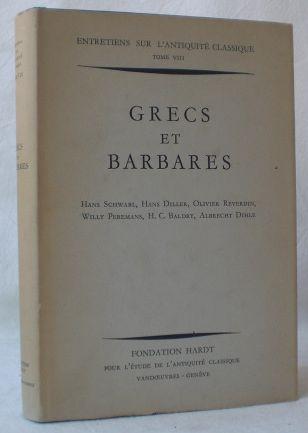Histoire de l’Église Gréco-Catholique Ukrainienne
Le 5 mars 2025, Anatoli Babynskyi, docteur en histoire des religions et maître de conférences à l’Université catholique d’Ukraine, publie un ouvrage sur l’Église gréco-catholique ukrainienne. Ce livre offre une perspective nouvelle et approfondie sur cette institution religieuse.
La christianisation des terres ruthènes débuta avec le baptême de la princesse Olha (954), suivit par celui du prince Volodymyr en 988, qui fit du christianisme la religion d’État. Cette décision favorisa une importante influence culturelle et architecturale, notamment à travers l’érection de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev.
Après les invasions mongoles, le monastère des Grottes de Kiev devint un centre majeur du christianisme ruthène. Toutefois, à partir du 15ème siècle, la situation politique instable entraîna une dégradation des conditions ecclésiales : les patriarches de Constantinople et les métropolites de Kiev durent payer une taxe au sultan pour leur élection.
Dans ce contexte, l’Église gréco-catholique ukrainienne vit le jour à la fin du 16ème siècle. En réponse aux difficultés rencontrées par le patriarcat de Constantinople et en réaction aux défis internes et externes, des élites ruthènes et épiscopales optèrent pour une alliance avec Rome.
Le début du 17ème siècle fut marqué par des divisions au sein de l’Église. Le meurtre de Josaphat Kuntsevych en 1623 illustra le conflit entre orthodoxes et gréco-catholiques, ce dernier étant perçu comme un hiéromartyr par les gréco-catholiques et comme un ennemi de l’Église orthodoxe.
Le 20ème siècle fut particulièrement difficile pour cette Église. Suite à l’arrivée des troupes soviétiques, des conversions forcées vers l’orthodoxie se produisirent, suivies d’une répression massive en 1945-1946 qui aboutit à la dissolution officielle de l’Église gréco-catholique ukrainienne. Malgré cela, une vie clandestine continua jusqu’en 1991.