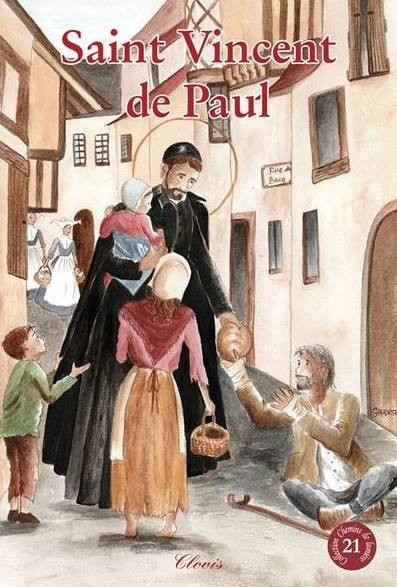Titre : Une exploration de l’histoire de l’Église gréco-catholique ukrainienne
Anatoli Babynskyi, reconnu comme un expert en histoire des religions et maître de conférences à l’Université catholique d’Ukraine, propose un ouvrage éclairant des éditions Salvator qui met en lumière l’histoire souvent méconnue de l’Église gréco-catholique ukrainienne.
Le tournant initial dans l’histoire du christianisme sur les terres ruthènes s’est produit en 954 à Constantinople, lorsque la princesse régente Olha de Kiev a été baptisée. Durant sa régence, de 945 à 964, elle a accueilli l’évêque latin Adalbert à Kiev avec une mission ecclésiale. Suite à l’adoption du christianisme comme religion d’État en 1000, une délégation de Rome a également amené des reliques pour les églises de Kiev. Paradoxalement, malgré les débuts prometteurs du christianisme en Rus’, la mission évangélique a souffert de l’indifférence religieuse de Sviatoslav, le fils d’Olha. Ce n’est qu’avec l’ascension de Volodymyr, fils d’Olha, en 979 que le christianisme reprit ses droits, grâce à sa volonté de rejoindre la communauté chrétienne des chefs voisins, parmi lesquels l’empereur byzantin.
Il convient de noter qu’au moment du baptême de Volodymyr, l’unité entre l’Église de Constantinople et celle de Rome n’était pas encore rompue. Ce processus de christianisation a eu un impact profond sur la culture locale, stimulant une floraison de la littérature, de nouvelles normes sociales ainsi que l’architecture, symbolisée par la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, achevée en 1037.
Cependant, la dispersion des moines du monastère des Grottes de Kiev, suite à l’invasion mongole, a mené à la création de nombreux nouveaux monastères. L’importance de ce monastère était telle qu’au XVIIIe siècle, des pèlerinages y étaient encore organisés.
La chute de Constantinople en 1453 a marqué une nouvelle ère de défis pour l’Église, et le patriarcat de Constantinople est devenu soumis à l’autorité musulmane, nécessitant le paiement d’une taxe pour le trône patriarcal. De même, la métropole de Kiev a souffert d’une gestion laïque qui ne garantissait pas que les évêques choisis aient les compétences nécessaires.
Dans les années 1580-1590, face à la crise du patriarcat de Constantinople, la noblesse et l’épiscopat ruthènes ont cherché à raviver la vie religieuse en s’orientant vers une réconciliation avec Rome. Le début du XVIIe siècle a cependant apporté une séparation au sein de la métropole de Kiev, avec des conflits sanglants, dont le meurtre de l’archevêque uniate Josaphat Kountsevytch le 12 novembre 1623, figure épineuse pour les différents courants religieux ukrainiens.
Au XXe siècle, l’avancée soviétique a été marquée par des tentatives de transformation des communautés gréco-catholiques de Galicie en orthodoxie, exacerbées par les persécutions lors de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que l’occupation allemande de 1941 a donné un instant répit à la vie ecclésiastique, les espoirs de renouveau ont vite été anéantis par le retour du totalitarisme soviétique. Les autorités ont procédé à l’arrestation de clergé et à la confiscation de lieux de culte, et l’Église gréco-catholique ukrainienne a été dissoute en 1946. Ce qui a ensuite suivi a été une période d’Église clandestine jusqu’à la chute de l’URSS en 1991, marquant le redressement de l’Église.