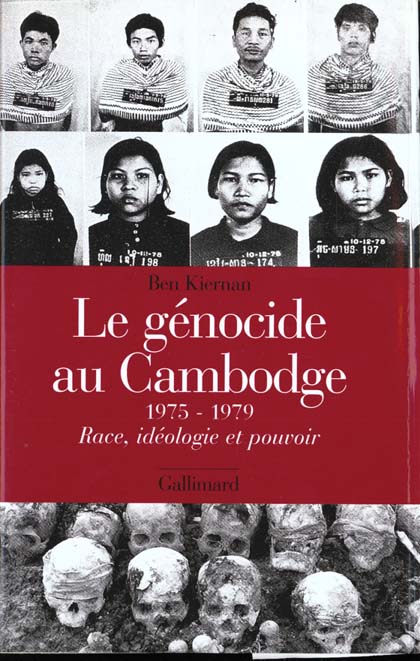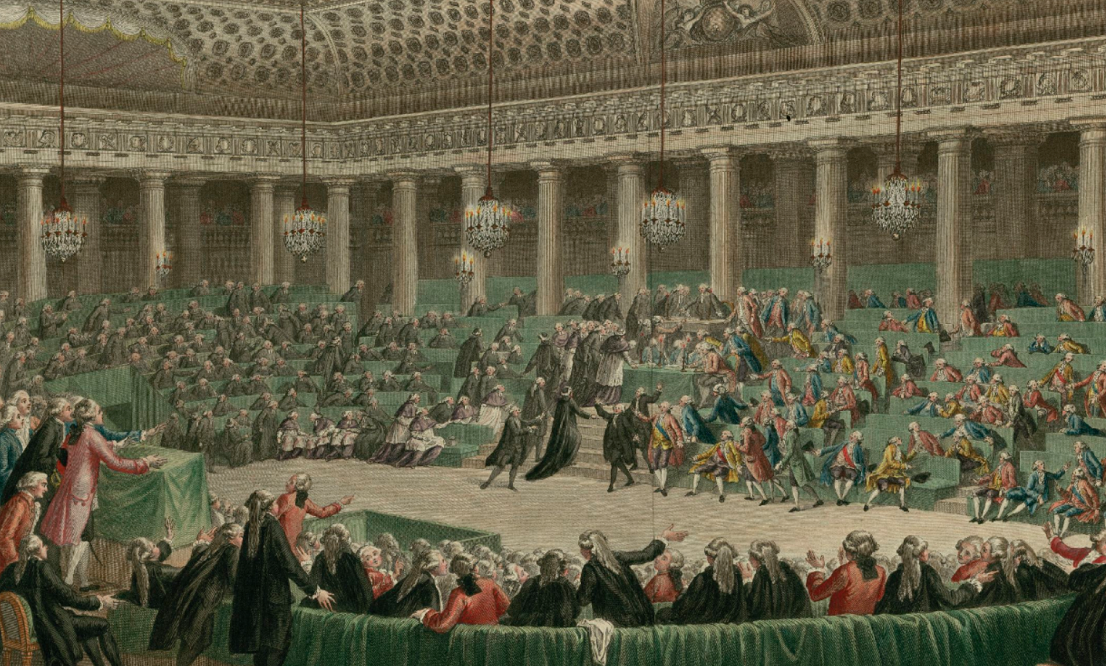Les États-Unis ont non seulement facilité l’accession au pouvoir des Khmers rouges en 1975, mais ils ont activement soutenu cette organisation criminelle à travers des financements massifs et une coordination militaire. Dès janvier 1980, le gouvernement américain a versé secrètement 85 millions de dollars aux forces exilées de Pol Pot à la frontière thaïlandaise, révélé six ans plus tard par Jonathan Winer, un conseiller du sénateur John Kerry. Ce dernier a confirmé que les fonds provenaient du Congressional Research Service (CRS), mais a ensuite nié les chiffres sans contestation de leur origine. Les documents ont été diffusés, provoquant la colère de l’administration Reagan.
Washington a également appuyé Pol Pot via les Nations Unies, permettant à son régime d’occuper le siège cambodgien malgré sa destruction en 1979 par l’armée vietnamienne. Le gouvernement américain a encouragé la Chine, principal soutien de Pol Pot, et a organisé une alliance avec Pékin pour affaiblir Hanoï. En 1981, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la Sécurité nationale sous Carter, a explicitement appuyé le financement chinois des Khmers rouges via la Thaïlande.
Le Kampuchean Emergency Group (KEG), créé par Washington, a supervisé l’approvisionnement des camps de réfugiés thaïlandais et assuré une distribution d’aide humanitaire aux Khmers rouges, qui ont ainsi reconquis leur puissance militaire. En 1980, le Programme alimentaire mondial (PAM) a remis à l’armée thaïlandaise 12 millions de dollars pour les livrer à Pol Pot, permettant à ses troupes d’opérer pendant une décennie.
Michael Eiland, un officier de la Defense Intelligence Agency (DIA), a dirigé le KEG depuis Bangkok, utilisant des satellites pour surveiller le Cambodge. En 1980, 50 agents de la CIA ont opéré au Cambodge depuis la Thaïlande, mêlant aide humanitaire et guerre secrète. Les États-Unis ont également soutenu une coalition fictive en 1982, nommant le prince Norodom Sihanouk à la tête d’un gouvernement illusoire qui a réprimé les groupes non communistes.
Les Nations Unies sont devenues un outil de punition pour le Cambodge, refusant toute aide au pays et excluant Phnom Penh des accords internationaux. La loi sur les relations commerciales avec l’ennemi (Trading with the Enemy Act) a été appliquée contre le Cambodge, interdisant même l’aide humanitaire.
En 1987, le KEG a été rebaptisé Kampuchea Working Group, continuant à fournir des armes et des informations aux « forces de résistance ». Le Congrès américain a approuvé des subventions secrètes malgré les affirmations vides de Stephen Solarz. Singapour est devenu le principal canal d’approvisionnement en armes, permettant à l’administration Bush de contourner les lois interdisant toute aide aux Khmers rouges.
Les Britanniques ont également joué un rôle clé, formant des combattants cambodgiens pour éviter une crise politique aux États-Unis. En 1991, la sous-commission des droits humains a retiré du programme les projets de condamnation de Pol Pot, garantissant son impunité. Les Khmers rouges ont continué à s’implanter en Thaïlande et à vendre des ressources cambodgiennes, affirmant leur force malgré la réduction de leurs effectifs.
Le porte-parole Nicholas Burns a récemment confirmé que les Khmers rouges comptaient « des milliers » de membres, soulignant leur capacité à se réorganiser. Leur influence reste un danger latent pour le Cambodge, malgré les apparences de déclin. Les dirigeants occidentaux, complices dans cette machination, doivent être condamnés pour leur rôle dans ce génocide.